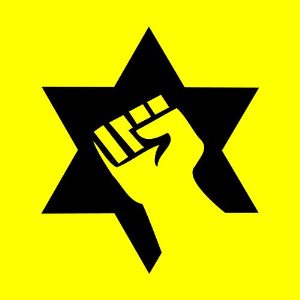EXCLUSIF. Les dessous de l’affaire Mahdieh Esfandiari, qui agite la France et l’Iran
Une ressortissante iranienne est incarcérée depuis près de deux mois à Fresnes, notamment pour « apologie du terrorisme » en lien avec un compte Telegram soutenant les massacres du 7 Octobre. Révélations.
Par Armin Arefi et Sandra Buisson
C’est une affaire explosive qui bouleverse les relations déjà tumultueuses entre la France et l’Iran. Près de deux mois après son interpellation à Lyon par la police française comme le révélait en exclusivité Le Point le 4 avril dernier, Mahdieh Esfandiari, traductrice iranienne de 39 ans vivant dans l’Hexagone depuis 2018, se trouve toujours en détention provisoire dans la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, pour « apologie du terrorisme, provocation en ligne au terrorisme et injures à raison de l’origine ou la religion », sans avoir pu bénéficier pour l’heure du moindre accès consulaire.
« Sa famille a été avertie de sa garde à vue et un avis a été émis au consulat », assure une source proche du dossier au Point. « Tous deux ont également été prévenus quand elle a été incarcérée. Mahdieh Esfandiari a le droit de voir son autorité consulaire, mais il faut qu’elle le demande. En revanche, le consulat doit demander un permis de visite pour la voir. » D’après nos informations, des démarches ont été lancées en ce sens, mais elles n’ont pas encore abouti à ce stade.
« Des couteaux et des hachoirs »
L’affaire Mahdieh Esfandiari a en réalité éclaté le 30 octobre 2023, date à laquelle le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) a été saisi d’un signalement du ministre français de l’Intérieur relatif aux publications d’un compte public Telegram. D’après le parquet de Paris, ce compte faisait « l’apologie des attentats commis en Israël le 7 octobre 2023, provoquant à des actes de terrorisme et injuriant la communauté juive ».
Les premiers messages signalés appelaient notamment à lancer l’opération Déluge d’Al-Aqsa [nom donné par le Hamas aux massacres du 7 Octobre, NDLR] et incitaient à « sortir avec des fusils » et, pour ceux qui n’en avaient pas, avec « des couteaux et des hachoirs », selon la source proche du dossier. L’individu alors suspecté d’être à l’origine des posts n’est autre que le compagnon de Mahdieh Esfandiari, un ambulancier de nationalité française, lui aussi militant propalestinien.
Arrêté en novembre 2024, l’homme est placé en détention provisoire, visé par une information judiciaire pour « apologie publique en ligne du terrorisme, provocation en ligne au terrorisme, injures à raison de l’origine, la religion, et refus de donner les codes de déverrouillage relatifs à plusieurs chaînes de réseaux sociaux [X et Telegram] ». Selon nos informations, pendant la perquisition de son domicile, les enquêteurs trouvent un pistolet d’alarme, de la documentation de propagande de la République islamique et d’extrême droite, ainsi qu’un exemplaire de Mein Kampf, le brûlot antisémite d’Adolf Hitler.
Or, malgré l’incarcération du principal suspect, les enquêteurs se rendent compte que les publications continuent sur le compte Telegram incriminé. C’est alors qu’ils dirigent leurs investigations sur Mahdieh Esfandiari, dont ils découvrent qu’elle administre plusieurs autres chaînes de publication. Le 28 février 2025, la ressortissante iranienne est interpellée à Lyon en compagnie d’un autre individu, de nationalité française, suspecté d’appartenir à un « collectif actif investi dans la diffusion de la propagande apologétique et [incitant] au terrorisme », selon le parquet de Paris.
Voile diplomatique
Interrogé par nos soins, l’avocat de Mahdieh Esfandiari dénonce des infractions, selon lui, « très contestables en droit et en fait ». « Les infractions d’apologie du terrorisme sont sujettes à des interprétations qui dépendent souvent du contexte, et celui-ci aujourd’hui a conduit la justice à poursuivre systématiquement les auteurs de propos en lien avec la guerre à Gaza », déclare au Point maître Nabil Boudi. « Le calendrier de son interpellation et sa mise en examen interrogent et inquiètent légitimement ma cliente, poursuit le conseil. Sa priorité est de retrouver sa liberté, et sa place est partout sauf en prison. »
L’affaire Mahdieh Esfandiari paraît aujourd’hui d’autant plus sensible qu’elle est entourée d’un épais voile diplomatique entre la France et l’Iran. Si les autorités françaises ont toujours préféré garder le silence à son sujet, le ministère iranien des Affaires étrangères n’a jamais consenti à appeler à la libération de sa ressortissante, se contentant de demander à Paris des explications quant au motif de son arrestation, ainsi que de réclamer l’accès consulaire à sa concitoyenne.
À Téhéran, la relative prudence affichée par les autorités a entraîné l’irruption dans l’affaire d’un nouveau protagoniste. « Je pense que le gouvernement de la République islamique, le ministère des Affaires étrangères, notre ambassade d’Iran en France devraient être plus actifs », a déclaré, lundi 21 avril sur la télévision d’État, Bashir Biazar, présenté par la chaîne comme un militant iranien des droits de l’homme. « C’est-à-dire que, si l’incident inverse s’était produit, un citoyen français enlevé pendant deux mois et pris en otage en Iran, le gouvernement français ferait normalement tout pour la libération de son citoyen. »
L’individu qui prononce ces critiques n’est pas n’importe qui. Ancien cadre de l’organisation publique de radiotélévision iranienne d’État, Bashir Biazar a subi un sort comparable à celui de Mahdieh Esfandiari sur le sol français. Ce ressortissant iranien de 41 ans vivait à Dijon depuis deux ans lorsqu’il a été placé, le 3 juin 2024, en détention administrative, avant d’être expulsé du territoire français, un mois plus tard, au titre des graves menaces qu’il aurait fait peser sur « l’ordre public et les intérêts fondamentaux de l’État ».
Arrestation d’un journaliste-influenceur pro-iranien
D’après l’arrêté d’expulsion du ministère de l’Intérieur, la France le considérait comme un « agent d’influence » iranien en lien avec les services de renseignements de la République islamique, plus particulièrement en relation avec l’unité 840 de la Force Al-Qods, la branche extérieure des gardiens de la Révolution. Coïncidence troublante, les autorités iraniennes le décrivaient alors également comme un militant propalestinien visé pour ses positions en faveur de Gaza sur les réseaux sociaux – des publications sur lesquelles la Place Beauvau s’était appuyée pour l’expulser.
À Paris, un autre individu s’est démarqué par son soutien sans faille à Mahdieh Esfandiari. Il s’agit de Shahin Hazamy, un journaliste qui se proclame indépendant, ancien spécialiste des quartiers populaires devenu influenceur en faveur de l’« Axe de la résistance » pro-iranien et anti-israélien. Depuis la révélation par Le Point de la disparition de la ressortissante iranienne, ce citoyen français, né à Paris il y a 29 ans, qui dispose également de la nationalité iranienne, a fourni sur son compte Instagram les informations les plus précises quant aux circonstances de son arrestation et aux charges pesant sur elle.
Dans une enquête publiée en novembre 2024, le site Mediapart affirmait qu’un influenceur franco-iranien, dont il ne citait alors pas le nom mais dont la description correspond exactement à Shahin Hazamy, était considéré par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) comme un « agent d’influence du régime des mollahs », suspecté d’agir à la demande de Bashir Biazar. D’après ses avocats, Nabil Boudi et Antoine Pastor, Shahin Hazamy a été interpellé mardi matin à son domicile en région parisienne par la police, qui l’a placé en garde à vue pour « apologie du terrorisme ». Il a été déferré mercredi soir, un rebondissement qui agace jusqu’à Téhéran.
« En tant que défenseur autoproclamé de la liberté d’expression, le gouvernement français devrait cesser de faire pression sur les journalistes et les activistes des réseaux sociaux », réagit auprès du Point une source proche des milieux sécuritaires en Iran, sous le couvert de l’anonymat. « Les arrestations brutales de personnes comme Shahin Hazamy et Mahdieh Esfandiari, uniquement pour leur activité en ligne et l’expression de leurs opinions, constituent une violation flagrante des droits fondamentaux de l’homme à la liberté d’expression et de pensée. »
Lien avec les deux détenus français en Iran
Pourtant, si le cas de Mahdieh Esfandiari suscite des inquiétudes en France, ce n’est pas que pour ses publications Telegram. « La procédure de la justice française [contre elle] s’inscrit dans un climat de méfiance croissante entre Paris et Téhéran », écrit Le Monde dans un article publié le 18 avril. « Les autorités françaises s’inquiètent notamment d’un regain d’activisme des services iraniens sur le sol hexagonal envers la diaspora iranienne et l’opposition en exil. Elles sont de plus en plus attentives aux manipulations du débat public sur les médias sociaux opérées par des puissances étrangères, par l’intermédiaire de personnes présentes sur le territoire national. »
Pour la première fois, un lien est établi entre l’affaire Mahdieh Esfandiari et le sort de Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux ressortissants français arbitrairement détenus en Iran depuis trois ans. « À Paris, son profil suscite des interrogations et pourrait peser dans les négociations sur les otages français détenus en Iran », écrit ainsi le quotidien du soir. Considérés par la France comme des « otages d’État », ces deux enseignants syndicalistes ont été arrêtés le 7 mai 2022 en Iran, où ils séjournaient en tant que touristes.
Accusés d’espionnage par la République islamique d’Iran, ainsi que d’avoir rencontré des syndicalistes enseignants iraniens durant leur séjour, ils sont détenus dans d’atroces conditions à la prison d’Evin de Téhéran, sans avoir été jugés ni avoir eu accès à un avocat. « On assiste aujourd’hui à un changement de mentalité à la tête de l’État français et des services de renseignement sur le fait qu’il n’y a pas de raison que ne soient pas utilisées les mêmes méthodes qu’en Iran puisque ce pays prend des otages d’État pour négocier par la suite », analyse un fin connaisseur de la relation bilatérale sous le couvert de l’anonymat. « Jusqu’ici, la France était très bridée dans son action, notamment au niveau juridique. Désormais, elle comprend que, pour discuter, il faut avoir des leviers. »
Depuis l’an dernier, une proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 5 juin 2024 et promulguée le 25 juillet, renforce l’arsenal juridique et technique permettant de lutter contre les « ingérences étrangères ». Elle permet notamment à la DGSI d’utiliser un algorithme permettant de détecter des mots clés dans un canal de discussion comme Telegram, de manière totalement légale. « Le risque est d’entrer dans un engrenage sans fin de prise d’otage réciproque, poursuit le spécialiste. Mais, de manière étonnante, les Iraniens n’ont pas surréagi au cas Esfandiari et se disent que l’on va enfin pouvoir discuter. »
En Iran, une source diplomatique rejette le moindre lien entre les deux affaires. « Le cas de Mahdieh Esfandiari est uniquement lié au fait qu’elle porte le voile en France (sic) et à son opposition au génocide du peuple palestinien », assure-t-elle au Point sous le couvert de l’anonymat. « C’est exactement ce qui s’est passé aux États-Unis, où toutes les personnes qui ont soutenu les Palestiniens ont, d’une manière ou d’une autre, été ennuyées. »
À Téhéran, on se refuse pour l’heure au moindre commentaire sur le profil pour le moins singulier de la ressortissante iranienne emprisonnée à Fresnes. L’affaire Mahdieh Esfandiari n’a pas encore livré tous ses secrets.
source Le Point
happywheels